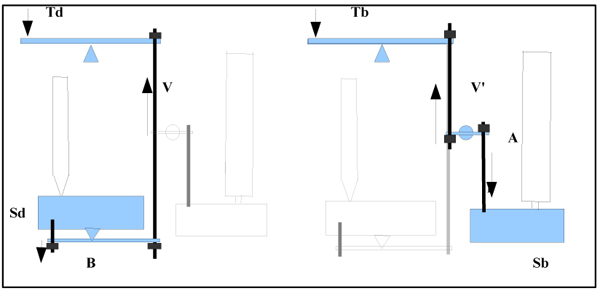![]()
en écoute : Orgue n° 1a "Sonata terza de
Frescobaldi"
Flûte à bec : Jean-Marie Segretier • Orgue : Nicolas André.
Enregistrement effectué dans l'église de Bretteville sur Odon
le 25 juin 2004.
![]()
Les chapitres
Prélude
Introduction
Plan
I Lexique (PDF 6,1 Mo)
II Description de mes orgues
L'Univers des petits orgues
Orgue n° 1
Orgue n° 2
Orgue n° 3
Orgue n° 4
Orgue n° 5
Claviorganum ou
Clavecin organisé
III Fabrication
Tuyaux
Sommiers
Claviers
Transmission
Soufflerie
Soufflet à membrane
Réflexions sur ces
instruments
Tailles et dimensions
IV
Éléments techniques pour la mise en œuvre d'un "ventilateur
intelligent"
1. Moteurs et contrôleurs
2. 1er circuit de test
3. Utilisation
d'un capteur de distance
4. Régulation
proportionnelle
5. Régulation
P.I.D.
6. Téléchargement des
programmes
Orgue n° 1a![]() Orgue
n° 1b
Orgue
n° 1b![]() Orgue
n° 1c
Orgue
n° 1c
Orgue n° 1a


![]() C’est
un petit instrument (orgue-coffre) de taille très réduite,
facilement transportable, idéal pour le continuo dans un
ensemble vocal ou instrumental. Il comporte un jeu de bourdon 8’
et un dessus de 4’ ouvert. Comme pour tous les positifs décrits
ici, la tuyauterie est en bois. L’orgue est construit sur une
structure métallique soudée en acier profilé de section carrée
qui assure la légèreté et une bonne rigidité pour le transport.
Le soubassement de l’orgue est détachable et contient le
dispositif de régulation de la pression du vent. Le ventilateur
est disposé dans une boite que l’on pose à côté de l’instrument.
Les dimensions de l’orgue sont : L : 0,80 m, H : 0,75 m, P :
0,40 m. Il n’y a pas de buffet : ce sont les tuyaux qui
constituent l’élément décoratif.
C’est
un petit instrument (orgue-coffre) de taille très réduite,
facilement transportable, idéal pour le continuo dans un
ensemble vocal ou instrumental. Il comporte un jeu de bourdon 8’
et un dessus de 4’ ouvert. Comme pour tous les positifs décrits
ici, la tuyauterie est en bois. L’orgue est construit sur une
structure métallique soudée en acier profilé de section carrée
qui assure la légèreté et une bonne rigidité pour le transport.
Le soubassement de l’orgue est détachable et contient le
dispositif de régulation de la pression du vent. Le ventilateur
est disposé dans une boite que l’on pose à côté de l’instrument.
Les dimensions de l’orgue sont : L : 0,80 m, H : 0,75 m, P :
0,40 m. Il n’y a pas de buffet : ce sont les tuyaux qui
constituent l’élément décoratif.
![]() Le
clavier possède quatre octaves, de Do1 à Do5. La première est
une «octave courte». La tuyauterie est portée par deux petits
sommiers indépendants. L’un alimente les 21 tuyaux des basses de
bourdon, directement posés sans registre. L’autre sommier porte
les 24 tuyaux (de Do# 3 à Do 5) de dessus de bourdon, également
sans registre ainsi que les tuyaux de dessus de 4’, disposés sur
une chape avec registre coulissant. Son tirage est effectué au
pied par un levier à déplacement horizontal alors que le bourdon
8' parle en permanence. Les 5 plus gros tuyaux de l'orgue sont
postés en dehors du sommier, Trois sont coudés deux fois ! Les
tuyaux de basses ne sont pas placés à l'aplomb de leur soupape,
à cause de leur encombrement. Ils sont donc alimentés par une
pièce gravée réalisée dans la table du sommier. L'orgue possède
69 tuyaux, 45 bourdons et 24 dessus de flûte de 4’ (ouverts).
Le
clavier possède quatre octaves, de Do1 à Do5. La première est
une «octave courte». La tuyauterie est portée par deux petits
sommiers indépendants. L’un alimente les 21 tuyaux des basses de
bourdon, directement posés sans registre. L’autre sommier porte
les 24 tuyaux (de Do# 3 à Do 5) de dessus de bourdon, également
sans registre ainsi que les tuyaux de dessus de 4’, disposés sur
une chape avec registre coulissant. Son tirage est effectué au
pied par un levier à déplacement horizontal alors que le bourdon
8' parle en permanence. Les 5 plus gros tuyaux de l'orgue sont
postés en dehors du sommier, Trois sont coudés deux fois ! Les
tuyaux de basses ne sont pas placés à l'aplomb de leur soupape,
à cause de leur encombrement. Ils sont donc alimentés par une
pièce gravée réalisée dans la table du sommier. L'orgue possède
69 tuyaux, 45 bourdons et 24 dessus de flûte de 4’ (ouverts). ![]() La
transmission comporte deux parties dédiées à chaque sommier.
Pour le sommier des dessus, c'est une transmission à balanciers.
Les tuyaux sont donc disposés en progression chromatique. Les
balanciers suspendus se situent sous le sommier, tout en bas de
l'instrument. La transmission pour le sommier des basses met en
œuvre des abrégés inversés (*) ce qui permet de disposer les
tuyaux en « mitre ». Outre l'aspect esthétique intéressant, cela
contribue à l'optimisation de l'emplacement des tuyaux afin de
réduire au maximum les dimensions du positif.
La
transmission comporte deux parties dédiées à chaque sommier.
Pour le sommier des dessus, c'est une transmission à balanciers.
Les tuyaux sont donc disposés en progression chromatique. Les
balanciers suspendus se situent sous le sommier, tout en bas de
l'instrument. La transmission pour le sommier des basses met en
œuvre des abrégés inversés (*) ce qui permet de disposer les
tuyaux en « mitre ». Outre l'aspect esthétique intéressant, cela
contribue à l'optimisation de l'emplacement des tuyaux afin de
réduire au maximum les dimensions du positif.

Tirant de registre du dessus de 4', actionné au pied.
Schémas
descriptifs de la transmission.
(cliquez sur l'image pour l'ouvrir en haute définition)
(*) Les bras de l'abrégé ne sont plus du même côté mais de part et d'autre du rouleau de sorte que l'un subit une traction alors que l'autre exerce une pression qu'il transmet à la soupape par un pilote pour l'ouvrir. Un tel abrégé est aussi appelé «abrégé foulant».

Le panneau au dessus de l'orgue étant soulevé, on peut voir le clavier et accéder aux écrous en cuir, vissés sur les vergettes V et V', pour le réglage mécanique de l'instrument.
![]() La
transmission est constituée de deux parties distinctes, l'une pour
actionner le sommier des dessus, l'autre pour celui des basses.
Les deux schémas représentent, de profil, chacune des deux
parties. A gauche, est représentée -en traits gras- la
transmission du sommier des dessus Sd. L'autre
partie est dessinée en gris clair Les touches Td,
qui correspondent aux dessus (Do#3-Do5), sont reliées par les
vergettes V aux balanciers suspendus B,
disposés sous le sommier, qui ouvrent, par un mouvement de
traction, les soupapes du sommier Sd. A droite,
j'ai représenté, en traits gras, le schéma de la transmission du
sommier des basses Sb (la partie décrite
précédemment figure maintenant en gris clair). Les touches Tb
(Do1-Do3) sont reliées, par les vergettes V',
aux abrégés inversés A qui ouvrent les soupapes
de sommier Sb par l'action des pilotes P
dans un mouvement de pression.
La
transmission est constituée de deux parties distinctes, l'une pour
actionner le sommier des dessus, l'autre pour celui des basses.
Les deux schémas représentent, de profil, chacune des deux
parties. A gauche, est représentée -en traits gras- la
transmission du sommier des dessus Sd. L'autre
partie est dessinée en gris clair Les touches Td,
qui correspondent aux dessus (Do#3-Do5), sont reliées par les
vergettes V aux balanciers suspendus B,
disposés sous le sommier, qui ouvrent, par un mouvement de
traction, les soupapes du sommier Sd. A droite,
j'ai représenté, en traits gras, le schéma de la transmission du
sommier des basses Sb (la partie décrite
précédemment figure maintenant en gris clair). Les touches Tb
(Do1-Do3) sont reliées, par les vergettes V',
aux abrégés inversés A qui ouvrent les soupapes
de sommier Sb par l'action des pilotes P
dans un mouvement de pression.
Sur la photo du haut, le tampon de laye est en place. Sur le sommier, on distingue:à l'avent, les trous percés directement dans la table pour recevoir les pieds des 21 tuyaux du dessus de bourdon, à l'arrière, l'emplacement des dessus de 4' sur une chape recouvrant un registre coulissant (2 tuyaux sont en place) Sur la photo inférieure, le tampon de laye a été ôté : on distingue: les soupapes, les esses ainsi que les boursettes en plomb. En arrière plan, on voit le panneau d'abrégés inversés pour la transmission des basses ainsi que les vergettes. A droite, sont disposées les vergettes qui relient les deux dernières octaves du clavier aux balanciers (non visibles) situés sous le sommier.

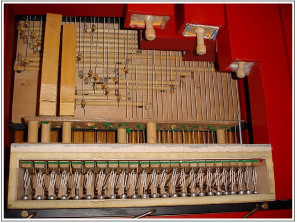
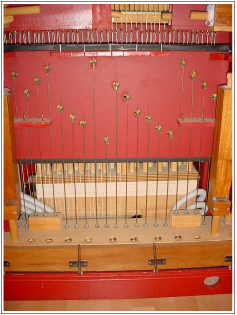
Schéma du régulateur de pression, situé dans le soubassement de l'orgue
![]() Je
décris, ici, un dispositif très proche de la méthode
traditionnellement utilisée dans les orgues. Je l'ai longtemps
employé mais je l'ai abandonné depuis la mise en œuvre d'une
méthode innovante et originale, particulièrement performante
au niveau de la qualité du vent et du silence de sa
production.
Je
décris, ici, un dispositif très proche de la méthode
traditionnellement utilisée dans les orgues. Je l'ai longtemps
employé mais je l'ai abandonné depuis la mise en œuvre d'une
méthode innovante et originale, particulièrement performante
au niveau de la qualité du vent et du silence de sa
production.
C'est donc l'ancien dispositif qui est décrit ici, le nouveau
fait l'objet du chapitre « Soufflerie ».
![]() Le
régulateur de pression est contenu dans le soubassement de l'orgue
: ABCD.
Le
régulateur de pression est contenu dans le soubassement de l'orgue
: ABCD.
L'air (non régulé) fourni par le ventilateur arrive par
l'ouverture latérale O dans la partie EBCF
qui communique avec la partie AEFD par
l'ouverture O' que vient obstruer la soupape
basculante S.
Le soufflet de régulation est constitué de la table TT'
chargée d'une masse de plomb M et reliée, de
façon étanche, à la boite AEFD par une membrane
souple mm'.
Lorsque le « soufflet » se gonfle, la table TT'
se soulève ; la tige t, munie à une extrémité de
la roulette R, appuie sur la soupape S
qui se ferme progressivement jusqu'à ce que la pression
corresponde à celle que détermine la masse M.
L'air régulé est envoyé aux sommiers par l'ouverture O''.
![]() La
pression de l'air dans cet orgue est de 5 cm d'eau.
La
pression de l'air dans cet orgue est de 5 cm d'eau.
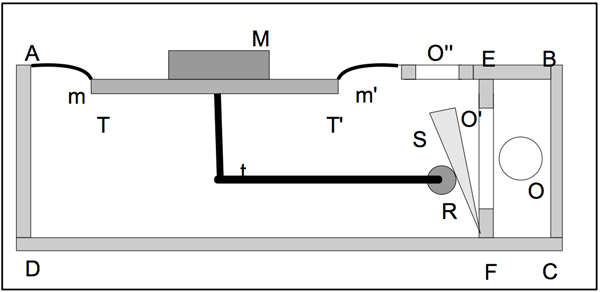
(cliquez sur l'image pour l'ouvrir en haute
définition)
Conclusion et réflexions sur cet orgue.
![]() Il
s'agit évidemment d'un très petit orgue, suffisant pour un
continuo. Les détails intéressants de sa conception résident dans
l'extrême facilité de transport et dans l'accessibilité de tous
ses éléments. L'accord et l'entretien ne posent aucun problème. Le
bâti métallique permet d'associer sa rigidité à la légèreté.
L'usage de petits sommiers facilite grandement la construction et
assure une bonne robustesse. La conception de la transmission,
associant abrégés et balanciers, ainsi que la présence d'une «
octave courte » ont permis une réduction à l'extrême des
dimensions de l'instrument.
Il
s'agit évidemment d'un très petit orgue, suffisant pour un
continuo. Les détails intéressants de sa conception résident dans
l'extrême facilité de transport et dans l'accessibilité de tous
ses éléments. L'accord et l'entretien ne posent aucun problème. Le
bâti métallique permet d'associer sa rigidité à la légèreté.
L'usage de petits sommiers facilite grandement la construction et
assure une bonne robustesse. La conception de la transmission,
associant abrégés et balanciers, ainsi que la présence d'une «
octave courte » ont permis une réduction à l'extrême des
dimensions de l'instrument.
![]() Ce
positif, très demandé par les ensembles d'instruments anciens ou
baroques, a sonné dans de nombreux édifices très variés allant de
cathédrales à des édifices plus modestes ; j'ai toujours trouvé
beaucoup de plaisir à chaque nouvelle « découverte » sous les
doigts d'instrumentistes souvent talentueux !
Ce
positif, très demandé par les ensembles d'instruments anciens ou
baroques, a sonné dans de nombreux édifices très variés allant de
cathédrales à des édifices plus modestes ; j'ai toujours trouvé
beaucoup de plaisir à chaque nouvelle « découverte » sous les
doigts d'instrumentistes souvent talentueux !
![]()

![]()
Orgue n° 1a![]() Orgue
n° 1b
Orgue
n° 1b![]() Orgue
n° 1c
Orgue
n° 1c
![]()
en écoute : Orgue n° 1a "Sonata terza de
Frescobaldi"
Flûte à bec : Jean-Marie Segretier • Orgue : Nicolas André.
Enregistrement effectué dans l'église de Bretteville sur Odon
le 25 juin 2004.
![]()